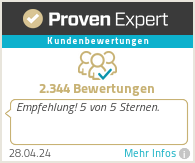Comme pour de nombreux intellectuels russes de sa génération, la révolution russe et l'arrivée des bolcheviks ont eu une influence existentielle sur la vie d'Ivan Jakovlevitch Bilibin. L'année de la révolution de 1917, l'artiste alors bien établi a quitté son pays pour s'exiler. Après ce départ forcé, l'aventurier s'est dirigé vers l'Arabie. Au cours des huit années qui suivirent, l'artiste tenta de s'établir en Égypte, mais il finit par quitter Le Caire et décida de vivre à Paris. La capitale française était devenue le refuge et la patrie de nombreux exilés russes, si bien que Bilibin s'est rapidement intégré dans leurs cercles. La communauté russe en exil resta son point de repère jusqu'en 1937. L'artiste a travaillé comme architecte d'intérieur pour les membres de l'élite russe et a aménagé leurs résidences à Paris. Cependant, sa vie prit une tournure inhabituelle dans les années politiquement agitées d'avant-guerre en France. Que ce soit par conviction ou en raison d'un mal du pays croissant, ou les deux, Bilibin retourna en Union soviétique en 1937 et participa activement à la création d'une scène artistique soviétique. Dans les années 1930, l'avant-garde européenne en matière de peinture, de sculpture et d'architecture regardait encore vers l'URSS et accompagnait avec intérêt le chemin qui y était parcouru. Bilibin releva ce défi à l'âge de 61 ans et devint membre de l'Académie panrusse des artistes à Leningrad. Cinq ans plus tard seulement, Bilibin est mort lors du blocus de Leningrad après l'invasion de l'Union soviétique par le Troisième Reich.
La politique a également joué un rôle décisif dans la première phase de création russe de l'artiste, dans les années qui ont précédé 1917. À 24 ans, il suit l'orientation intellectuelle de l'élite russe vers l'ouest et entreprend des études d'art à Munich. Après son passage à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, Bilibin s'est rapidement forgé une excellente réputation dans le domaine du graphisme de journaux et de livres. Mais c'est lors d'un projet du département ethnographique du musée Nicolas III que le jeune homme de 26 ans a trouvé sa vocation. En tant que photographe et illustrateur, Bilibin a collecté entre 1902 et 1904 des témoignages de la culture villageoise de l'ancienne Russie. Le contact avec ses racines slaves l'amène à s'intéresser aux contes et légendes de Russie, qu'il illustre. Parallèlement, il travaille comme décorateur de théâtre très demandé dans les théâtres russes les plus connus.
Lors de la révolution de 1905, Bilibin apparaît pour la première fois comme un radical bourgeois progressiste et fournit les illustrations politiques pour le magazine satirique "Zupel", ce qui lui vaut d'être vu par la police secrète du tsar. En 1906, le magazine fut officiellement interdit et l'artiste se concentra dès lors sur les recherches ethnographiques, les illustrations de livres et les travaux de théâtre. La culture quotidienne russe et les particularités de l'âme russe ne le quittent plus au cours des années suivantes et il salue les événements révolutionnaires du printemps 1917. Mais avec la victoire des bolcheviks qui se dessine et l'instauration de l'Union soviétique, le bourgeois finit par tirer les conséquences et quitte sa patrie, sans toutefois jamais la laisser complètement derrière lui.
×





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1062394).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1062394).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_Costume_pour_lopera_Prince_-_(MeisterDrucke-1325419).jpg)
_Costume_pour_lopera_Prince_-_(MeisterDrucke-1325419).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1318694).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1318694).jpg)
.jpg)
.jpg)
 from Album du Pere Castor published by Flammarion 1937 (colour engraving) - (MeisterDrucke-156704).jpg)
 from Album du Pere Castor published by Flammarion 1937 (colour engraving) - (MeisterDrucke-156704).jpg)
.jpg)
.jpg)
 1909 - (MeisterDrucke-93001).jpg)
 1909 - (MeisterDrucke-93001).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1061651).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1061651).jpg)
.jpg)
.jpg)
_Heros_des_legendes_du_folklore_russe_chevauchant_-_(MeisterDrucke-1323469).jpg)
_Heros_des_legendes_du_folklore_russe_chevauchant_-_(MeisterDrucke-1323469).jpg)
.jpg)
.jpg)
_(The_Expulsion_of_Batu_Khan)_Batou_che_-_(MeisterDrucke-1320445).jpg)
_(The_Expulsion_of_Batu_Khan)_Batou_che_-_(MeisterDrucke-1320445).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1061646).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1061646).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1061637).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1061637).jpg)
.jpg)
.jpg)
 - (MeisterDrucke-286342).jpg)
 - (MeisterDrucke-286342).jpg)
 1909 - (MeisterDrucke-95826).jpg)
 1909 - (MeisterDrucke-95826).jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1061652).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1061652).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1061645).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1061645).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_Rimski_Korsak_-_(MeisterDrucke-1323466).jpg)
_Rimski_Korsak_-_(MeisterDrucke-1323466).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1061644).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1061644).jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1061638).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1061638).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(Illust_-_(MeisterDrucke-1323357).jpg)
_(Illust_-_(MeisterDrucke-1323357).jpg)
_(Administering_J_-_(MeisterDrucke-1318199).jpg)
_(Administering_J_-_(MeisterDrucke-1318199).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1061643).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1061643).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1064376).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1064376).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1064379).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1064379).jpg)
.jpg)
.jpg)
_Rimski_Korsakov_(Rimsk_-_(MeisterDrucke-1323489).jpg)
_Rimski_Korsakov_(Rimsk_-_(MeisterDrucke-1323489).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_Costume_pour_lopera_Le_conte_du_tsar_Saltan_de_Nicolas_(Ni_-_(MeisterDrucke-1313596).jpg)
_Costume_pour_lopera_Le_conte_du_tsar_Saltan_de_Nicolas_(Ni_-_(MeisterDrucke-1313596).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-1056334).jpg)
_-_(MeisterDrucke-1056334).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_Oeuvre_de_Iva_-_(MeisterDrucke-1320441).jpg)
_Oeuvre_de_Iva_-_(MeisterDrucke-1320441).jpg)
_Conte_traditionnel_russe_Oeuvre_de_Ivan_Yakovlevi_-_(MeisterDrucke-1320442).jpg)
_Conte_traditionnel_russe_Oeuvre_de_Ivan_Yakovlevi_-_(MeisterDrucke-1320442).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)